note de lecture d'Antoine Emaz à propos de Ludovic Degroote et Jacques Lèbre
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Le Phare du Cousseix fait partie de ces lieux d’édition que l’on
rencontre par hasard et auxquels on s’attache parce qu’ils s’inscrivent
dans une tradition poétique du livre mince, illustrée par GLM mais
présente bien avant lui. Avec les revues et les livres d’artistes, la
plaquette est sans doute une spécificité de l’édition de poésie. On
aurait tort de minimiser son rôle et de confondre légèreté et
fragilité ; certaines « maisons » font vraiment partie du paysage,
depuis le temps : Potentille, La Porte, Polder, Pré de l’âge,
Contre-Allées, Ficelle… sans oublier les très regrettés Petits
classiques du grand pirate ou Wigwam. Le plus souvent, ces éditions
reposent sur les épaules et l’abnégation d’une personne qui maintient le
cap à force de volonté, de passion, et de bouts de ficelle. Pour le
Phare du Cousseix, il s’agit de Julien Bosc. Il publie deux à trois
livres par an et on pourrait dire que ces plaquettes s’inscrivent dans
la suite de la belle feue collection Wigwam de Jacques Josse : une
douzaine de pages de texte, deux in quarto sous une couverture à
rabats, sobre. Pour un poète, l’espace idéal pour une courte suite de
poèmes ou de proses qui ont une autonomie forte : c’est le cas pour les
deux livres, très différents, de Degroote et Lèbre.
 Llanover-Blaenavon
est un bref récit, le trajet en voiture entre les deux bourgades
irlandaises du titre. Le paysage se déroule : quelques fermes isolées,
talus, murets, taillis et au-delà « rien à voir que la lande,(…) la
lande et puis la lande » (p.12). Paysage beckettien, difficile à décrire
« tant il n’y a rien qui ne puisse dire rien » (p.4). A ce vide du
dehors correspond le vide du « je », solitaire conducteur sur cette
route à une voie : « il n’y a rien à gagner à être sur la lande, qu’à
essayer de comprendre ceci : je roule sur la route qui mène de Llanover à
Blaenavon » (p.13) Le trajet n’est donc pas l’occasion d’une rêverie ou
d’un basculement dans les circuits de mémoire, ni même d’une quelconque
pensée suivie ou d’éclats de vie pratique, passé immédiat ou futur
proche. Sauf, tout à la fin, la mention minimale d’autres personnes que
le « je » va retrouver. Le personnage n’est occupé que par cette courte
expérience du vide et de la solitude existentielle face à un monde
indifférent. L’enjeu n’est donc ni le paysage ni la couleur locale,
malgré les noms irlandais aux sonorités étranges qui parsèment le
texte : « il ne s’agit que de nous – et plus exactement du rien de
nous. » (p.14)
Llanover-Blaenavon
est un bref récit, le trajet en voiture entre les deux bourgades
irlandaises du titre. Le paysage se déroule : quelques fermes isolées,
talus, murets, taillis et au-delà « rien à voir que la lande,(…) la
lande et puis la lande » (p.12). Paysage beckettien, difficile à décrire
« tant il n’y a rien qui ne puisse dire rien » (p.4). A ce vide du
dehors correspond le vide du « je », solitaire conducteur sur cette
route à une voie : « il n’y a rien à gagner à être sur la lande, qu’à
essayer de comprendre ceci : je roule sur la route qui mène de Llanover à
Blaenavon » (p.13) Le trajet n’est donc pas l’occasion d’une rêverie ou
d’un basculement dans les circuits de mémoire, ni même d’une quelconque
pensée suivie ou d’éclats de vie pratique, passé immédiat ou futur
proche. Sauf, tout à la fin, la mention minimale d’autres personnes que
le « je » va retrouver. Le personnage n’est occupé que par cette courte
expérience du vide et de la solitude existentielle face à un monde
indifférent. L’enjeu n’est donc ni le paysage ni la couleur locale,
malgré les noms irlandais aux sonorités étranges qui parsèment le
texte : « il ne s’agit que de nous – et plus exactement du rien de
nous. » (p.14)
Le plus
étrange dans ce texte bref et économe de moyens, c’est sa radicalité et
son impact. Etonnant aussi de voir combien ce « trajet », publié une
première fois dans la revue Limon en 1989 (une note indique ce
détail), peut préfigurer en miniature ce qui sera développé bien plus
largement dans le premier livre de Degroote, La Digue (éd. Unes, 1995 – repris en feuilleton par Poezibao
en 2011 et par Publie.net en 2012). A condition de transposer « lande »
en mer, « route » en digue, et « je roule » en je marche. Mais le poids
d’extériorité du dehors est semblable : le paysage n’accueille ni ne
rejette, il est seulement là, terriblement neutre, et le « je » qui le
traverse ne fait que l’expérience de sa solitude fragile. Aller simple
d’une vie.
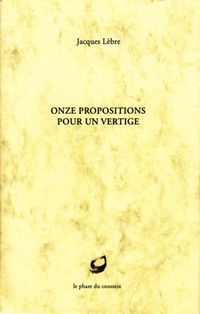 Le livre de Jacques Lèbre, Onze propositions pour un vertige,
est très différent au premier abord, mais peut-être pas tant que cela
au fond, pour ce qui est de la solitude d’être. Dans cet ensemble clos
de onze poèmes courts en vers libres, le poète évoque la figure d’un
écrivain âgé, habité par le vertige et l’instabilité de perdre la
mémoire. Par délicatesse et amitié, Lèbre ne le nomme pas, même si la
personne peut être reconnue en filigrane à travers l’exergue de Jacques
Réda. Mais là n’est pas l’enjeu du livre, il s’agit de faire revivre un
peu cet être coupé des autres et de lui-même, et une « amitié
démeublée » lorsque « la conversation n’est plus possible » (p.15).
Le livre de Jacques Lèbre, Onze propositions pour un vertige,
est très différent au premier abord, mais peut-être pas tant que cela
au fond, pour ce qui est de la solitude d’être. Dans cet ensemble clos
de onze poèmes courts en vers libres, le poète évoque la figure d’un
écrivain âgé, habité par le vertige et l’instabilité de perdre la
mémoire. Par délicatesse et amitié, Lèbre ne le nomme pas, même si la
personne peut être reconnue en filigrane à travers l’exergue de Jacques
Réda. Mais là n’est pas l’enjeu du livre, il s’agit de faire revivre un
peu cet être coupé des autres et de lui-même, et une « amitié
démeublée » lorsque « la conversation n’est plus possible » (p.15).
Il y a autant de compassion que d’interrogation de la part de Jacques
Lèbre vis-à-vis de ce « tu » très proche et devenu si énigmatique.
Beaucoup passe par le regard : celui de Lèbre est attentif aux détails
matériels, aux faits minimes qui signalent la maladie, son évolution ;
le regard de l’ami, lui, dit souvent une « désorientation » (p.11) :
« Dans tes yeux, égarés tes yeux, / on ne sait quoi de volatil – qui
s’enfuit, / ne se réfugie pas, non, / chez un être privé de tous ses
souvenirs, / il n’y a plus de lieu pour un refuge. » (p.13)
Ces poèmes sans emphase ni larmes touchent par leur humanité, leur
retenue : c’est solitude contre solitude, et la séparation finale n’est
pas tragique mais constat mélancolique forcé, acceptation triste :
l’autre ne se/me reconnaît plus, il est parti trop loin. Comme si, sans
mémoire, il avait « peut-être » une éternité d’avance (p.14). « Sur
l’esplanade ventée de la gare, / reste le sentiment d’un au revoir raté /
dans une froide lumière d’avril. » (p.15)
Antoine Emaz in Poezibao →
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications